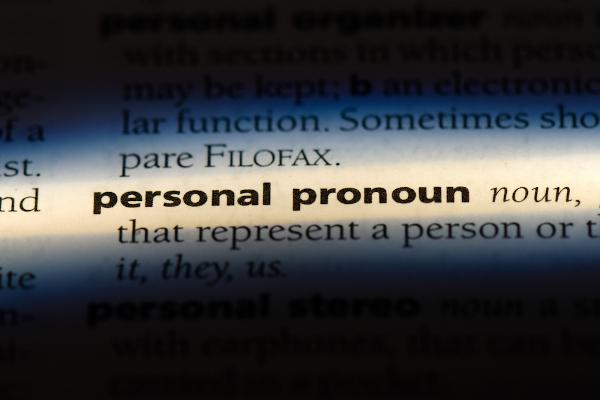LES représentation des noirs dans la littérature brésilienne il renforce divers stéréotypes dans les œuvres, ce qui rend un mauvais service à cette partie de la société, qui a longtemps été traitée avec mépris et mépris. La présence de personnages noirs dans la littérature, quand il y en a, se produit, le plus souvent, dans rôles secondaires mineurs ou méchants. Les représentants noirs dans le protagonisme ne sont pas souvent trouvés et, quand ils le sont, ils sont presque toujours liés à environnements prédéterminés.
A lire aussi: Qu'est-ce que le racisme et qu'est-ce que le racisme structurel?
La représentation des Noirs dans la littérature brésilienne
Selon l'Enquête nationale continue par sondage auprès des ménages (PNAD) de 2015 les noirs et les bruns représentent 54% de la population brésilienne. Au milieu de ce scénario de diversité, il prédomine dans le bon sens, la théorie répandue de démocratie raciale, qui présente le Brésil comme un pays dit non raciste.
Cependant, les chiffres du Continuous Pnad de 2017 indiquent une autre réalité: alors que le salaire moyen des Noirs est de 1570 R$, celui des Bruns est de 1606 R$ et celui de la population blanche atteint 2814 R$. À
disparités ils ne s'arrêtent pas là: dans le groupe des 1% les plus riches de la population brésilienne, le pourcentage de Noirs et de Bruns n'était que de 17,8%.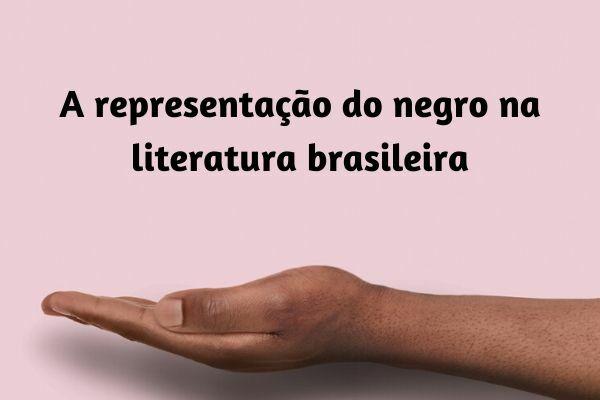
Ce contexte témoigne d'une abîme social dans la société brésilienne. LES abolition du travail forcé, il y a un peu plus d'un siècle, ne garantissait pas, comme le montrent ces chiffres, l'insertion de la population noir et brun en tant que citoyen sur le territoire brésilien, du moins pas à égalité avec la population Blanc.
Parmi les différents facteurs qui contribuent à cette inégalité raciale, fondée sur la logique de la colonisation, qui a kidnappé des millions d'Africains pour les condamner à l'esclavage sur les terres brésiliennes, la la littérature apparaît comme un grand vecteur de préjugés, soit en naturalisant des stéréotypes négatifs liés aux Noirs, soit par l'absence de personnages noirs dans leur ensemble. C'est le cas, par exemple, de la projet nationaliste de le romantisme Indianiste, qui comprend la généalogie brésilienne à la suite de la rencontre raciale entre Européens et indigènes, soustrayant la présence noire de la population nationale.
O scène de la littérature contemporaine n'est pas différent. Selon une enquête du Groupe d'étude de la littérature contemporaine de l'Université de Brasilia, 70 % des les ouvrages publiés par les grands éditeurs brésiliens entre les années 1965 et 2014 ont été écrits par des hommes, de qui sont 90% sont blancs et au moins la moitié d'entre eux sont originaires de São Paulo ou de Rio de Janeiro. Les personnages représentés se rapprochent eux-mêmes de la réalité de ces auteurs: 60% des œuvres sont réalisées par des hommes, 80% d'entre eux blancs et 90% hétérosexuels.
Toujours selon la même enquête, entre 2004 et 2014, seuls 2,5% des auteurs publiés n'étaient pas blancs, et seulement 6,9% des personnages représentés étaient noirs. Dans seulement 4,5% des histoires qu'ils apparaissent comme protagonistes. Entre 1990 et 2014, les cinq principales occupations des personnages noirs dans les œuvres analysées étaient: criminel, domestique, esclave, travailleuse du sexe et femme au foyer.
« Dans la littérature brésilienne, le personnage noir occupe une place plus petite, souvent inexpressive et presque toujours rôle secondaire, ou méchant dans le cas masculin, maintenant dans les personnages l'infériorité qui leur est donnée comme reflet de l'époque trimer."|1|
Voir aussi : 20 novembre - Journée nationale de la conscience noire
Personnages noirs dans la littérature canonique brésilienne: stéréotypes
Le noir apparaît dans la littérature brésilienne bien plus comme un thème que comme une voix d'auteur. Ainsi, la plupart des productions littéraires brésiliennes présentent des personnages noirs à partir de points de vue qui mettent en évidence les stéréotypes de l'esthétique blanche eurocentrique dominante. C'est une production littéraire écrite principalement par des auteurs blancs, dans laquelle les noirs font l'objet d'une littérature qui réaffirme les stigmates raciaux.
La chercheuse Mirian Mendes rappelle que les stéréotypes sont « la base idéologique de la domination des noirs par les blancs ». Le professeur et chercheur Domício Proença Filho signale les principaux stéréotypes :
le noble esclave
Ici le noir serait celui qui est fidèle, soumis, qui surmonte toutes les humiliations et surmonte la cruauté des seigneurs en blanchiment. C'est le cas du personnage principal de Esclave Isaura, dans Bernardo Guimarães, publié en 1872 et adapté en feuilleton télévisé par Rede Globo en 1976 et par Rede Record en 2004. Isaura est la fille d'une mère noire et d'un père portugais, et a la peau claire. Voir un extrait du roman, dans lequel Isaura s'entretient avec Sinhá Malvina :
« - Je n'aime pas que tu la chantes, Isaura. Ils penseront que vous êtes maltraité, que vous êtes un esclave malheureux, victime de maîtres barbares et cruels. En attendant, vous passez ici une vie qui ferait l'envie de beaucoup de gens libres. Vous jouissez de l'estime de vos maîtres. Ils vous ont donné une éducation, car ils n'avaient pas beaucoup de femmes riches et illustres que je connaisse. Tu es belle et tu as une belle couleur, que personne ne dira qu'une seule goutte de sang africain tourbillonne dans tes veines.
[...]
– Mais madame, malgré tout cela que je suis plus qu'une simple esclave? Cette éducation qu'ils m'ont donnée, et cette beauté dont je suis si fier, ce qu'ils me servent... Ce sont des objets de luxe placés dans les quartiers des esclaves africains. Le quartier des esclaves ne cesse d'être ce qu'il est: un quartier des esclaves.
– Tu te plains de ta chance, Isaura ?
– Pas moi, madame: malgré tous ces dons et avantages, qu'ils m'attribuent, je connais ma place.
Le dialogue transparaît et réaffirme les paradigmes actuels: la blancheur comme synonyme de beauté, l'héritage africain comme maudit, bienveillance des maîtres envers l'esclave, la perpétuation de cet état de fait qui se termine par le discours d'Isaura « Je connais mon endroit".
la victime noire
Créé pour exalter le projet abolitionniste, le noir est ici aussi mis en scène avec le soumission servile, victime d'un système inhumain. C'est le cas de plusieurs poèmes de Castro Alves, comme « A Cruz da Estrada », où la mort apparaît comme l'unique chance de libération de l'esclave noir, ou encore le célèbre « Le navire négrier », dans lequel le poète il rappelle les années perverses de la traite négrière et mentionne de grands noms européens comme Colombo et Andrada, mais il n'est même pas fait mention de la résistance noire, la quilombos, le Zombi ou Luiza Mahin.
"Marcheur! de l'esclave déshonoré
Le sommeil vient de commencer !
Ne le touche pas sur le lit de fiançailles,
La liberté vient de l'épouser.
(Versets finaux de « A Cruz da Estrada », Castro Alves)
Ce stéréotype est également associé à la esclave fidèle et passif, présent dans plusieurs ouvrages, tels que Mère Marie, conte pour enfants de olavo bilac, publié dans le livre Contes de pays (1904):
« Acheter et vendre des esclaves était, à cette époque, une chose naturelle. Personne n'a interrogé un homme noir acheté sur son passé, tout comme personne n'a essayé de savoir d'où venait la viande dont il se nourrissait ou la ferme dans laquelle il s'habillait. D'où venait la vieille Maria quand, peu après ma naissance, mon père l'a achetée? Je sais seulement qu'elle était africaine; et peut-être a-t-elle eu un passé terrible: car, interrogée à ce sujet, une grande terreur ses yeux se dilatèrent et ses mains noires, luisantes et calleuses étaient secouées d'un tremblement. convulsif. Avec nous, votre vie était presque heureuse.
(Olav Bilac, Mère Marie)
voir le naturalisation en esclavage et l'effacement complet du passé du personnage, où « Africaine » cache ses origines et tous les termes se prêtent à une indétermination De Marie. L'absence de la famille contribue à l'encadrer sous le paternalisme blanc, « presque heureux ».
A lire aussi: Trois grands abolitionnistes noirs brésiliens
le noir infantilisé
Caractérisé comme subalterne et serviteur, est le stéréotype qui le place comme incapable. Présent dans des œuvres telles que le diable familier (1857), de José de Alencar, et les aveugles (1849), de Joaquim Manuel de Macedo. Domício Proença Filho associe également ce stéréotype à animalisation de Bertoleza, personnage de l'immeuble (1900), de Aluisio Azevedo:
"Bertoleza était celui qui continuait avec la souche tordue, toujours le même sale nègre, toujours maladroit de service, sans dimanche ni jour saint: celui-là, rien, rien absolument, elle participait aux nouveaux avantages de son ami: au contraire, à mesure qu'il gagnait en statut social, la malheureuse devenait de plus en plus esclave et rampant. João Romão monterait et il resterait en bas, abandonné comme un cheval dont nous n'avons plus besoin pour continuer notre voyage.
(l'immeuble, Aluisio Azevedo)
C'est aussi le cas pour Tante Nastasia, caractère de Monteiro Lobato, confinée à la cuisine où elle travaille au service d'une famille blanche, présentée comme « une femme noire de compagnie qui a porté Lúcia enfant » (Monteiro Lobato, Les règnes du petit nez), dont les histoires sont souvent disqualifié par les autres personnages :
— Eh bien, ici avec moi, dit Emilia, je n'accepte ces histoires que comme des études sur l'ignorance et la stupidité des gens. Je ne ressens aucun plaisir. Ils ne sont pas drôles, ils ne sont pas humoristiques. Ils me semblent être très grossiers et même barbares - quelque chose même avec une femme noire gonflée, comme tante Nastácia. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, et je n'aime pas ça!
[...]
– Eh bien, vous pouvez voir qu'elle est noire et chatte! Il n'a pas de philosophie, ce diable. Sina est ton nez, tu sais? Tous les vivants ont le même droit à la vie, et pour moi, tuer un agneau est un crime encore plus grand que de tuer un homme. Facinateur! »
(Monteiro Lobato, Les histoires de tante Nastasia)

En plus d'être considérées comme ignorantes, les caractéristiques de leur phénotype noir, telles que la couleur de la peau et la taille de la bouche, sont agencées pour devenir également offensantes, synonymes de laideur et d'infériorité.
A lire aussi: Carolina Maria de Jesus, l'une des premières écrivaines noires brésiliennes
Le noir animalisé, hypersexualisé et perverti
Présenter à le bon nègre (1885), d'Adolfo Caminha, est le personnage noir qui incarne l'homosexualité, pris à l'époque comme perversion. C'est aussi le cas du roman La viande (1888), œuvre de Júlio Ribeiro, qui associe la libération des instincts sexuels de la protagoniste (blanche) Lenita à promiscuités avec les esclaves. Il apparaît également dans la figure de Rita Baiana, de l'immeuble (1900), et dans plusieurs œuvres de Bernardo Guimarães, comme Rosaura: l'enfant trouvé (1883):
« Adélaïde était, comme le lecteur le sait déjà, d'une beauté plastique et plus provocante. Sa poitrine turgescente, toujours soulevée dans une ondulation morbide, semblait le nid de la tendresse et du plaisir; son regard à la fois plein de douceur et de feu, comme si elle répandait des étincelles divines sur toute sa figure; les joues roses, les lèvres pourpres étaient comme ces museaux scellés qui, au paradis, séduisaient les ancêtres de l'humanité et provoquaient leur première culpabilité; et la voiture douée d'élégance naturelle, avec ses ondulations voluptueuses et ses ondulations gracieuses, semblait chanter éternellement l'hymne de l'amour et de la volupté; les traits, pas tout à fait corrects, étaient animés d'un visage d'une expression si enchanteresse, qui imposait l'adoration, sans laisser le temps à l'observation.
LES érotisation et objectivationde la femme noire est l'un des stéréotypes les plus répandus non seulement dans la littérature brésilienne, mais aussi dans la représentation des femmes noires en général - puisque Grégoire de Matos, poète du XVIIe siècle, au personnage récemment disparu de Globeleza, une vignette diffusée pendant 26 ans sur Rede Globo, montrant toujours une femme noire nue comme une icône du carnaval.
Comparons, ci-dessous, deux extraits de poèmes de Gregório de Matos: le premier, un parmi tant d'autres dédié à D. Angela de Sousa Paredes, jeune fille blanche; la seconde, à Jelu, la « reine des mulâtres » :
"Ange au nom, Angélique au visage,
Ceci doit être une fleur et un ange ensemble,
Étant Angelica Flower et Angel Florent,
En qui, sinon en toi ?
[...]
Si comme un Ange tu es de mes autels,
Tu étais mon gardien et mon gardien,
Il m'avait débarrassée de malheurs diaboliques.
[...]”
Comparé à un être angélique, à des fleurs, à une amulette contre le mal, D. Angela est le portrait de la beauté et des vertus. Concernant Jelu, le même poète dit :
« Jelu, tu es la reine des mulâtres.
Et, surtout, tu es la reine des putes.
Tu as le commandement sur le dissolu
Qui vivent dans les épiceries de ces chats.
[...]
Mais étant toi mulâtre si gracieux
Si belle, si fringante et enjouée,
Vous avez un mal, que vous êtes très merdique.
Pour devant le personnage le plus enclin
Déroulant l'intestin révoltant,
Quel blanc vous gagnez, vous perdez de la merde.
Loin de l'idéalisation spiritualisée de l'amour platonique inspirée du D blanc. Angela, Jelu est facilement transfiguré dans "chat", dans figure d'animal, chez une femme prostituée, contrairement au portrait angélique de la première. outre érotisé, objectivé, pris comme impur, Jelu doit encore comparer sa beauté à un décor sordide et fétide.
Il existe d'innombrables productions qui perpétuent cette stéréotype érotisé de la femme noire. C'est le cas des femmes mulâtres de Jorge Amado, avec un accent particulier sur Gabriela, protagoniste de Gabriela clou de girofle et cannelle (1958), décrite avec une sensualité et une beauté qui rendent les hommes fous et comme une femme qui s'abandonne à la passion, mais pas à la poursuite d'un engagement affectif ou amoureux :
« Il a attaqué une mélodie de sertão, il avait la gorge nouée, son cœur était affligé. La fille se mit à chanter doucement. Il était tard dans la nuit, le feu de joie mourait dans la braise, quand elle s'allongea à côté de lui comme si de rien n'était. Une nuit si sombre, ils ont failli ne pas se voir. Depuis cette nuit miraculeuse, Clément vivait dans la terreur de la perdre. Il avait d'abord pensé que, étant arrivé, elle ne le lâcherait plus, elle courrait sa chance dans les bois de cette terre de cacao. Mais il a vite perdu ses illusions. [...] Elle était naturellement rieuse et enjouée, elle échangeait même des grâces avec le noir Fagundes, distribuait des sourires et obtenait ce qu'elle voulait de tout le monde. Mais la nuit venue, après s'être occupée de son oncle, elle venait dans le coin le plus éloigné, où il irait, et s'allongeait à côté d'elle, comme si elle n'avait pas vécu toute la journée pour autre chose. Elle s'est livrée à elle-même, abandonnée entre ses mains, mourant dans des soupirs, gémissant et riant."
Luís Fernando França, dans son mémoire de maîtrise, énumère, sur la base de l'analyse de Roger Bastide, plus d'une vingtaine de stéréotypes associés aux noirs dans la production littéraire brésilienne. Parmi eux, ceux de la voyou, de ivre ou accro à Sorcier ou "macumbeiro", du mal etc.
« Quelques exemples: qui ne se souvient pas des vers de Manuel Bandeira, « Black Irene, Good Irene, Irene toujours de bonne humeur »? Ou la femme mulâtre sauvage, qui n'est jamais une femme de jour, seulement une femme de nuit; ce n'est jamais esprit, seulement chair; n'est-ce jamais la famille ou le travail, juste le plaisir? Et on connaît bien le complément masculin de ce costume blanc: le mulâtre coquin, venu faire la fête et à bien des vices, facteur de dégénérescence et de déséquilibre social. Ces fantômes et tant d'autres émergent de notre passé d'esclavage pour habiter encore le L'imaginaire social brésilien, où des figurations comme le « bon seigneur » ou le « bon patron"; de « l'esclave content » ou de son contraire, le marginal sanguinaire et psychopathe, naturellement tourné vers le crime. Ces distorsions et tant d'autres de l'identité afro-brésilienne sont inscrites dans nos paroles, autant que dans le film, à la télévision ou dans les programmes populaires qui se propagent sur les ondes radio. Ce sont des stéréotypes sociaux qui sont largement répandus et assumés même parmi leurs victimes, des stéréotypes qui fonctionnent comme des éléments puissants pour maintenir les inégalités. »
(Eduardo de Assis Duarte, « La littérature afro-brésilienne: un concept en construction »)
A lire aussi: Conceição Evaristo: un autre grand représentant de la littérature noire-brésilienne
littérature noire
C'est principalement à partir des années 1960, avec le renforcement des mouvements sociaux organisés par des hommes et des femmes noirs, que ce scénario a commencé à changer. Cherchant à rompre avec ce recueil centenaire de préjugés et de stéréotypes véhiculés par la littérature canonique brésilienne, qui souvent diminue ou efface les caractères noirs, auteurs et auteurs noirs et noirs ont commencé àpublier vos propres travaux comme instrument de subjectivation et de détermination culturelle.
Des chiffres comme Luiz Gama, avocat et poète romantique abolitionniste 19ème siècle, ou Maria Firmina dos Reis, la première femme auteur à écrire un roman abolitionniste au Brésil, sont souvent reléguées au oublié par le canon littéraire brésilien, mais repris comme précurseurs du mouvement pour la littérature noir.
Conception Evaristo, par exemple, a la plupart de ses œuvres mettant en vedette Femme noire, et c'est à partir du substrat de ses expériences et de son intériorité que se construisent les vers et les intrigues de son œuvre. Solano Trindade revendique la noirceur et le phénotype noir avec fierté et présence. Ana Maria Gonçalves reprend le thème de la femme noire asservie en tant que sujet conscient et révolutionnaire, rappelant les véritables soulèvements et résistances de l'histoire brésilienne. Jarid Araès, en utilisant principalement le ficelle, met également en évidence les guerriers quilombolas.
![Portrait de Conception Evaristo. [1]](/f/21382b1e0572bcf1f65df6038879b52d.jpg)
Il existe d'innombrables auteurs et auteurs engagés dans reprendre le point de vue du noir, continuellement ignoré par la littérature brésilienne. Cela implique un sauvetage de l'ascendance et de l'identité noires, ainsi que la dénonciation de l'oppression :
Mahin demain
La conspiration se fait entendre dans les coins
des voix basses chuchotent des phrases précises
la lame des poignards court dans les ruelles
La foule trébuche sur les rochers
Révolte
il y a une volée d'oiseaux
chuchoter, chuchoter :
« C'est demain, c'est demain.
Mahin a dit, c'est demain.
Toute la ville se prépare
Masculin
bantou
gèges
nagos
les robes colorées gardent espoir
attendre le combat
Le grand renversement blanc est mis en place
le combat est tracé dans la langue des Orixás
"c'est demain, demain"
chuchotement
Masculin
bantou
gèges
nagos
"C'est demain, Luiza Mahin je parle"
(Miriam Alves, dans Carnets noirs: les meilleurs poèmes)
Futur
quelle afrique
est imprimé
chez les élèves
de la grand-mère noire
quelle danse
la congada ?
combien de zombies
se posera
en poésie
de la périphérie battue?
c'est dégueulasse
quelle danse
et occupe le câlin
de la fille tressée ?
quel orisha
voir
pour ce garçon
qui aime
jouer au foot?
un souffle ancien
de tambours et de voix
Protège nous
du mal
le moderne, le nouveau
couler dans la rivière
traditionnel
il n'y a personne
pas d'histoire
sans mémoire
collectif
et c'est sur la peau
que ce souvenir
toujours en vie
(Marcio Barbosa, dans cahiers noirs, vol. 31)
savoir plus: Le concept de littérature noire et plus d'exemples d'œuvres
Encore, cette production littéraire a encore du mal à s'intégrer au canon et elle est continuellement reléguée à la marginalité. Ainsi, il y a une difficulté totale à dissiper ces stéréotypes et à véhiculer une littérature engagée à représenter la population brésilienne dans son ensemble. La relation entre littérature et réalité est évidente lorsque des enquêtes comme celles de l'UnB révèlent que le profil de l'écrivain Le brésilien est resté le même depuis 1965, maintenant le privilège des publications des grandes maisons d'édition pour hommes blancs.
Notes
|1| Maria de Lourdes Lopedote, « La littérature et l'image afro-brésilienne », 2014.
Crédit image
[1]: Paula75/Avecmons
par Luiza Brandino
Professeur de littérature
La source: École du Brésil - https://brasilescola.uol.com.br/literatura/a-representacao-negro-na-literatura-brasileira.htm